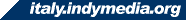La nuit de Vincent Bonnecase au dépot de Bolzaneto
C'était le vendredi 20 juillet, il devait être à peu près quinze heures. J'étais
sur la Piazza Manin avec les manifestants qui, comme moi, participaient à la
« Pink March », marche pacifique. Quelques dizaines de militants,
vraisemblablement des « Black Blocks », sont alors arrivés sur la place,
marchant au pas en forme de défilé. Chacun s'est écarté pour les laisser
passer. Plusieurs minutes après, j'ai entendu des cris, senti les gaz
lacrymogènes, tout le monde s'est mis à courir. C'était la police
(j'emploierai les termes de « police » et de « policier » à titre générique,
faute de pouvoir précisément définir à quel corps appartiennent les forces
de l'ordre qui interviennent dans mon histoire) qui chargeait. Les
manifestants de la « Pink March » se sont retrouvés totalement dispersés.
Je me suis retrouvé avec une quinzaine d'amis dans une ruelle, cherchant à
fuir ce que l'on supposait être un lieu d'affrontement entre police et « Black
Blocks ». Un groupe d'une vingtaine de policiers casqués et armés de
matraques est arrivé dans la ruelle. Ne sachant par où aller, on a levé les bras
en l'air et on s'est tous assis en signe de non-violence. Les policiers ont
couru jusqu'à nous et, sans sommation, sans rien nous dire, se sont mis à
nous matraquer. J'entendais des cris, « stop », « arrêtez », mais les coups
continuaient. Au bout de quelques minutes, comme j'étais à une extrémité
du groupe, ils m'en ont extrait, m'ont jeté dans un coin à deux ou trois
mètres et, là, se sont acharnés sur moi. Ils étaient peut-être quatre ou cinq,
ils me donnaient des coups de pieds, des coups de matraques, visant d'abord
la tête mais aussi le corps et les membres. Profitant d'un moment de répit, je
me suis levé tout titubant en disant « calme, calme ». Ils m'ont alors traîné
jusqu'au groupe de mes amis immobiles et serrés les uns contre les autres et,
d'un signe, m'ont donné l'ordre de me coucher à côté d'eux, ce que j'ai fait.
L'un des policiers à continuer à me matraquer, un autre à me donner
quelques coups de pieds. Et puis ils sont partis.
On s'est alors relevé. Deux de mes amis m'aidaient à tenir debout. J'avais
la tête en sang, du sang dégoulinait sur mes habits et sur ceux de l'amie
contre laquelle j'étais couché pendant la charge. J'avais aussi le front enflé
sur la partie gauche. Une autre fille de notre groupe, Leslie, saignait de la
tête. On a marché quelques mètres vers une plus grande artère. Une
ambulance italienne qui passait s'est fait arrêter par mes amis. J'y suis
monté avec Leslie, celle-ci étant accompagnée de Gwendal, un autre
manifestant de la « Pink March » qui n'avait pas été blessé.
A l'hôpital, j'ai été rapidement pris en charge par plusieurs médecins. L'un
m'a d'abord désinfecté les plaies puis recousu le crâne avec trois points de
suture. Un autre m'a ensuite fait une radio de la tête avant de me dire qu'il
n'y avait pas de problème. Un autre m'a enfin fait comprendre que je
pourrais repartir après avoir rempli quelques formalités avec la police.
Celle-ci avait installé un bureau dans le hall d'entrée de l'hôpital. Un
policier est arrivé et m'a emmené dans une petite salle proche du hall
d'entrée. J'y étais vite rejoint par une jeune allemande au bras plâtré qui
disait s'être fait casser le bras à coups de matraque par la police alors qu'elle
participait à la « Pink March ». Elle a demandé à voir un avocat et à sortir
immédiatement de l'hôpital. Le policier qui nous gardait a refusé de la
laisser sortir mais a fait venir de l'extérieur deux personnes,
vraisemblablement les avocats demandés, les seuls que j'ai vus pendant ces
vingt-quatre heures. Ils parlaient italien, l'un maîtrisant quelques
rudiments d'anglais. La rencontre a vite tourné court, peut-être deux ou
trois minutes sans qu'ils prennent notre identité, puis ils sont partis.
D'après ce que j'avais compris, nous devions accepter de délivrer notre
identité précise à la police, suite à quoi nous pourrions sortir de l'hôpital.
Nous avons donc continué à attendre. D'autres blessés ont rejoint la petite
salle gardée, parmi lesquels Leslie, toujours accompagnée de Gwendal. Nous
étions peut-être sept.
C'est alors que d'autres policiers sont arrivés. Deux se sont emparés de
moi, l'un à mes côtés qui a pris ma radio, l'autre derrière qui me maintenait
les poignets dans mon dos en les levant vers la nuque jusqu'à me faire mal.
Ils allaient très vite. Dès qu'on est sorti dans la cour de l'hôpital, un policier
a dit à la policière qui me tenait quelque chose que je ne compris pas. Une
caméra filmait. Elle m'a relâché les poignets avant de les reprendre à
l'identique, une fois passée la caméra. Des voitures de police attendaient à la
sortie de l'hôpital. Elle m'a fait monter dans l'une d'entre elles et, en
compagnie de son collègue, est montée à l'avant. Une vitre plastifiée me
séparait d'eux. Je voyais à travers la fenêtre mes compagnons d'hôpital subir
le même sort que moi. Le cortège de voitures de police, une petite dizaine,
s'est élancé dans la ville. On a pris l'autoroute direction « Milano » et, au
bout de plusieurs minutes, on est sorti à Bolzanetto. C'est là qu'on est
rentré dans la cours d'un poste de police. D'après l'heure que j'avais
demandée avant de quitter l'hôpital, il devait être entre cinq et six heures.
Je me suis retrouvé dans la cour avec les autres compagnons de l'hôpital.
Un policier m'a demandé mon identité. Un autre a regardé le rapport
médical succinct qui accompagnait la radio de l'hôpital avant de faire un
signe d'acquiescement à d'autres policiers. Ceux-ci m'ont alors emmené
dans un bâtiment. J'ai traversé un couloir avec, sur la gauche, trois ou quatre
salles éclairées au néon avec des barreaux aux fenêtres et dans laquelle
j'aperçus des policiers et, alignés contre le mur, des jeunes gens. Ils me
menèrent jusqu'à la dernière de ces salles. A l'intérieur se trouvaient une
quinzaine de jeunes gens, certains blessés avec, à leurs pieds, ce que je
supposais être une radio d'hôpital, les autres apparemment indemnes
physiquement. J'arrivais pour ma part avec le crâne recousu et le front
endolori. Certains des jeunes gens avaient des menottes en plastique
derrière le dos, les autres étaient face et mains contre le mur. C'est cette
deuxième position qu'on me fit adopter en me projetant violemment contre
le mur tout en me donnant des coups de pieds. Un policier me vida les
poches dans laquelle se trouvaient mon porte-monnaie avec une carte
d'identité française, une carte bleue, de l'argent et des chèques français, une
montre et des bouts de papiers, l'un comportant notamment un numéro
d'avocat du GSF. Tout fut mis dans l'enveloppe qui contenait la radio de
l'hôpital et mis à mes pieds.
Alors a commencé dans cette salle une longue attente que j'ai pu évaluer
rétrospectivement et de manière approximative à cinq heures. Comme mes
compagnons de cellule, je devais rester dans la même position sans bouger
ni regarder autour de moi. J'avais très soif, je me sentais faible, à cause de
ma blessure, aussi parce que je n'avais rien mangé depuis le matin. Des pas
venaient et partaient, s'approchaient régulièrement de moi avant que ne
tombent des coups de pieds et de poings, dans le dos et les jambes
essentiellement. Des mains, de temps en temps, me saisissaient
brusquement pour changer légèrement la position, en levant plus ou mois
mes bras ou en écartant plus ou moins mes jambes, le tout accompagné de
coups et d'injonctions en italien. D'autres mains me saisissaient parfois la
tête pour claquer contre le mur mon front endolori. Le mur était blanc et j'y
voyais des traces de mon sang s'y déposer. Entre les coups et, laissant les
yeux tourner de gauche à droite, je voyais mes compagnons de cellules subir
le même sort. L'un d'entre eux, muni de menottes en plastique se les faisait
régulièrement resserrer. De temps en temps, un policier entrait en appelant
un nom et l'un d'entre nous sortait. Il arrivait aussi que de nouveaux jeunes
gens arrivent. J'ai demandé au bout d'un certain temps, en français et en
anglais, si je ne pouvais pas voir un avocat. Aucune réponse n'est venue. Et
les coups ont ensuite repris de manière ponctuelle.
Au bout de peut-être deux heures, un policier m'a saisi par la nuque et m'a
montré à deux policiers qui venaient manifestement d'entrer. Ceux-ci,
après m'avoir examiné quelques secondes, ont secoué la tête en signe de
négation et ma tête fut ramenée au mur. Peu de temps après, un homme,
vraisemblablement médecin, a demandé de me retourner. Il portait un
grand tablier et un stéthoscope autour du cou. Il a regardé ma tête, m'a
demandé en anglais si je ne voulais pas dormir - j'ai compris « évanouir » -
et, par signe, si je ne voulais pas vomir. Je lui ai fait comprendre que je me
sentais faible. Il est sorti. Deux policiers se sont approchés de moi en riant et
m'ont touché le front en me demandant en anglais ce que j'avais. Je leur ai
répondu que j'avais été frappé par des policiers. L'un des deux m'a alors pris
par l'épaule en criant : « By a policeman ' Impossible ! You've fallen on the
floor, OK ? » Je me suis retourné vers le mur sans rien dire. Le médecin est
vite revenu pour appliquer contre mon front une compresse glacée avant de
me plaquer à nouveau tête et front contre le mur. L'attente a repris,
toujours ponctuée de coups.
Peut-être une heure à deux heures plus tard, alors que la salle me semblait
se vider peu à peu, j'ai entendu une voix de femme me dire en anglais de
m'asseoir. C'était une policière accompagné d'un collègue. Elle a fait asseoir
chacun d'entre nous. J'ai regardé autour de moi. Nous n'étions plus qu'une
petite dizaine dont Gwendal que j'apercevais seulement. J'ai vu qu'il faisait
nuit. J'ai demandé à la femme en anglais si je pouvais être assisté d'un
avocat. Elle a souri en me faisant signe de garder le silence.
Peut-être trente à quarante minutes plus tard, plusieurs policiers sont
entrés en criant des choses que je ne comprenais pas, je me suis senti
soulevé et plaqué la tête contre le mur. Plusieurs coups de pieds ont suivi. Ca
recommençait comme avant. Pour moi, cela n'a pas duré longtemps. J'ai
entendu au bout de quelques dizaines de minutes mon nom. Je me suis
retourné. Un policier m'a fait signe de le suivre. J'ai voulu ramasser
l'enveloppe dans laquelle se trouvaient mes affaires mais il m'a pris par le
bras. J'ai désigné l'enveloppe en disant « document, paper » mais il m'a
emmené dehors. Il était d'allure robuste, parlait calmement sans élever le
ton de la voix, possédait des rudiments de français et d'anglais. Il n'allait pas
me lâcher jusqu'à ce que je sorte du poste de police. Il devait être près de
minuit.
Il m'emmena vers un autre bâtiment. Plusieurs jeunes gens, peut-être
trois, étaient à l'extérieur, tête contre le mur. Il me fit prendre la même
position, à leurs côtés. Il s'est approché près de moi en me disant : « merde
de français, tu vas souffrir ». « Pourquoi ? » j'ai demandé. Il m'a répondu : «
tu es français, tu as frappé Gênes, je veux que tu souffres ». J'ai dit que
j'étais dans des groupes pacifistes mais il m'a frappé le front en disant : « je
vois ». Et à nouveau il a répété, « merde de français, tu vas souffrir ». Il a
alors pris d'une main mon bras gauche, juste au-dessus du coude, s'est mis à
le malaxer, à le tordre comme s'il voulait disjoindre le biceps du reste du
bras. Je criai. Il me lâcha, me ramena en arrière en disant : « ne crie pas » et
me projeta violemment contre le mur. Il recommença le même geste, je
gémissais faiblement et de plus en plus fort jusqu'à ce que le cri sorte. Un
autre policier en civil me décrocha alors des coups pieds dans le tibia tandis
que lui répétait : « il ne faut pas crier ». Ce jeu continua longtemps sans
discontinuité, peut-être une à deux heures. Régulièrement, quand ma
respiration devenait heurtée, il s'arrêtait quelques minutes pour que je
puisse reprendre haleine. Il lui arrivait aussi de me poser des questions en
italien et, comme je répondais que je ne comprenais pas l'italien, me donner
coups de pieds et de poings dans les jambes, les côtes et le dos. Et, toujours,
les torsions de bras recommençaient.
Il m'a ensuite emmené à l'intérieur du bâtiment dans un couloir où étaient
alignés une petite dizaine de jeunes gens. L'un d'entre eux, torse nu, avait
sur le dos des marques de coups profondément marqués dans la chair. Je
remarquais aussi une jeune fille aux pieds desquels se trouvait
vraisemblablement une enveloppe de l'hôpital avec une radio. Je fus mis
tête contre le mur. J'entendais des cris et des gémissements dans les salles
voisines. Cela dura peut-être un quart d'heure. Le policier qui s'occupait de
moi me prit alors par le bras pour m'emmener dans une salle devant un
policier en civil très corpulent et au crâne rasé. Il y avait derrière lui une
machine à écrire. Il demanda d'où je venais, l'autre lui dit que je venais de la
France. Il s'est mis alors à crier dans mes oreilles qu'il ne parlait pas le
français, c'est ce que j'ai compris, et à me bousculer vers le dehors. Le
policier qui s'occupait de moi m'a alors replacé dehors et a repris les
torsions de bras. Je criai brusquement : « pourquoi ? », il dit quelque chose
que je ne compris pas avant de continuer, tandis qu'un autre répondait à
mes cris par des coups de pieds dans le tibia ou en me claquant la tête contre
le mur.
Un médecin a ensuite interrompu le jeu pour examiner ma tête. Il m'a
demandé en anglais si je voulais dormir, si j'avais vomi, peut-être était-ce
le même que la fois précédente. Je ne me rappelle pas avoir répondu quoi
que ce soit. Il m'a donné une nouvelle compresse glacée pour me l'appliquer
contre le front. Quelques minutes plus tard, le policier m'a emmené vers un
autre couloir dans lequel de trouvait une soixantaine de policiers. Il a crié en
italien, d'après ce que je compris, « voilà un personnage illustre ! » Ils se
sont mis à rire, je devais avoir la tête déformée. Tout en reprenant les
torsions de bras, il m'a baladé de part et d'autre du couloir entre deux
rangées de policiers pour que ceux-ci me donnent des coups de pieds et des
coups de poings. Nous avons ainsi fait deux ou trois aller-retour dans le
couloir, cela n'a pas duré cinq minutes. Le policier m'a ensuite ramené à
l'endroit d'où je venais juste.
Après une courte attente, il m'a emmené dans une grande salle dans
laquelle opéraient plusieurs groupes de policiers, de jeunes dactylographes,
d'hommes habillés de blouse blanche, avec plusieurs types d'appareils.
J'aperçus Leslie et la jeune allemande au bras cassé qui attendaient. Le
policier m'a emmené dans un coin pour qu'on me prenne les empreintes
digitales. D'une main, il continuait les torsions de bras, de l'autre, il
mangeait un sandwich. Un homme en blouse blanche me prenait en même
temps la main laissée libre pour y prendre mes empreintes, tout en discutant
tranquillement avec le policier qui s'occupait de moi. Une jeune
dactylographe regardait la scène en souriant. Les empreintes de chacun de
mes doigts furent prises. On me prit ensuite en photo, face et profil, à
plusieurs reprises. Chaque séquence était ponctuée de pauses.
Le policier qui ne me lâchait pas le bras me fit ensuite asseoir devant un
bureau autour duquel se trouvaient d'autres policiers. C'était toujours dans
la même grande salle. Un de ces policiers me présenta trois fiches blanches
en haut desquelles se trouvaient ce que je supposai être mes empreintes
digitales. Il me tendit un stylo en me demandant de signer. Je demandai «
pourquoi ? » Le policier qui s'occupait de moi me tordit le bras puis
m'expliqua en français qu'il s'agissait de mes fiches et qu'il fallait qu'elles
portent mon nom. Je pris les trois fiches blanches et y apposai mes nom et
prénom au bas. Un autre policier me présenta ensuite une feuille portant un
texte dactylographié en italien. Ce texte comportait trois espaces remplis
manuscrits, le premier avec mon nom et les deux autres avec des horaires,
23h30 crus-je lire pour le dernier. Le policier qui s'occupait de moi me
demanda de signer au bas de la page. Je dis que je ne lisais pas l'italien. Le
policier me tordit le bras en me disant qu'il fallait signer si je voulais partir.
J'essayais de lire le texte mais je ne parvenais pas à me concentrer. Je lui dis
que je voulais comprendre le texte. Il me dit que je n'irais pas en prison, que
je serais libre si je signais. Je lui dis que je voulais bien signer pourvu qu'il
me traduise le texte. Il prit alors la feuille et dit quelques phrases en français
dont je saisis mal le sens. D'après ce que je comprenais, c'était une
déclaration selon laquelle j'étais arrivé à telle heure au poste de police et
ressorti à telle autre. Je signai.
Le policier m'a alors emmené dehors pour me conduire vers le porche
d'entrée du poste de police. Il y avait une longue allée à parcourir. Un autre
policier m'accompagnait en me faisant au bras droit les torsions à la base du
biceps, les mêmes que m'avaient faites au bras gauche pendant plusieurs
heures le policier qui s'occupait de moi. Celui-ci continuait de me tordre le
bras gauche tout en marchant à mon rythme. Les deux policiers
m'injuriaient, « merde, merde », tout en riant et en discutant entre eux.
D'après ce que je comprenais, ils semblaient tester le degré de résistance à la
douleur de mes deux bras. Au bout de l'allée, le porche s'ouvrit et ils me
lâchèrent. Le policier qui s'occupait de moi m'a pris par l'épaule et m'a dit :
« Regarde-moi. Je suis à Genova demain. Si je te vois à Genova, je t'arrête
». Il m'a ensuite dit de rejoindre la ville à pieds en m'indiquant la mauvaise
direction. Je suis parti. D'après un groupe d'italiens que j'ai croisé quelques
dizaines de minutes plus tard, il devait être alors à peu près trois heures du
matin.
from: http://www.aarrg.org/index2.html
|